Que retenir de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion de l’eau dont Olivier Serva, député LREM de Guadeloupe, était le rapporteur ? Lancée en janvier dernier à l’initiative du groupe La France insoumise (LFI) et présidée par la députée LFI du Val-de-Marne Mathilde Panot, son rapport a été adopté à l’unanimité le 15 juillet, après 4 mois de travaux, 81 auditions et 100 heures d’échanges avec 245 universitaires, associatifs, élus ou responsables d’entreprises. Si l’intitulé de l’enquête visait ” la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés “, un tiers de ce travail a porté sur l’Outre-mer. Et 24 auditions, plus un déplacement sur place, ont été centrés sur la Guadeloupe.
La situation est urgente. “En Guadeloupe, la population vit au rythme des tours d’eau. Certains n’ont pas d’eau depuis six ans. Les conséquences du non-accès à l’eau sont immenses. Ainsi des enfants ratent jusqu’à un mois et demi de cours par an car il n’y a plus d’eau à l’école”, explique le rapport en introduction, évoquant des factures exorbitantes de 5 000, 6 000 ou 8 000 euros et des familles ” plongées dans des situations financières impossibles “. Pourtant, l’eau est abondante. La Guadeloupe dispose d’une ressource en eau parmi les plus élevées au monde, avec un potentiel disponible de 7 000 m3 par habitant et par an, contre 3 000 m3 dans l’Hexagone. Mais elle est gaspillée en fuites. L’efficacité des réseaux étant de 35 % seulement, les nappes phréatiques sont aujourd’hui surexploitées et risquent la salinisation, écrit le rapporteur. En cause : le sous-investissement dans le renouvellement des réseaux.
Comment en est-on arrivé là ? ” La conjonction de plusieurs facteurs a entraîné la distribution de l’eau dans un cercle vicieux, entre 2012 et 2016 “, écrit le rapporteur. Qui met en avant l’accident industriel causé par le changement de logiciel de facturation par la Générale des eaux, mi-2011. Il a engendré des factures émises avec retard, des rattrapages, des erreurs aussi, qui ont provoqué retards ou refus de paiement. Et des appels à ne pas payer. Le Siaeag, pendant près de dix-huit mois, n’a rien facturé alors que dans le même temps, ses dettes fournisseurs s’accumulaient. Le taux de factures impayées s’est envolé. Ce bug a renforcé une particularité guadeloupéenne. Le taux de factures impayées, déjà élevé est passé de 10 % en 2008 (contre 0,6 % à 0,8 % dans l’Hexagone) à 20 % au sein du Siaeag en 2011. Il a atteint 33 % en moyenne, jusqu’à culminer à 43 % dans le périmètre du Siaeag en 2018. En plus, le Siaeag a mis fin en 2008 aux coupures d’eau pour non-paiement que la loi Brottes a interdites en 2013, rendant plus difficiles les recouvrements. Et des élus ont incité les gens à ne pas payer, rappelle le rapporteur. Les particuliers ne sont pas seuls en cause. 20 % du total des impayés sont le fait des administrations : le port, le CHU et plusieurs communautés d’agglomération sont concernés. Baisse des recettes et hausse des coûts plombent le renouveau du réseau. Les collectivités ont fixé un prix de l’eau le plus bas possible pour l’usager, écrit le rapporteur. Et le Siaeag a fait fondre la surtaxe destinée à financer les investissements nécessaires au renouvellement des canalisations posées après-guerre et aujourd’hui en fin de vie. Les accords Bino, après la crise financière de 2009, ont prévu une baisse du prix de l’eau, une hausse des salaires des agents de l’eau et (…) la suppression des pénalités appliquées à ceux qui ne payaient plus leur eau, a expliqué Frédéric Certain, ancien président de la Générale des eaux Guadeloupe. En permettant d’un côté à la Guadeloupe de sortir d’une passe difficile, ils ont contribué de l’autre à déstabiliser la situation. Deux événements ont aussi modifié la donne. Le départ du Siaeag de l’ex-CASBT devenue aujourd’hui Grand sud Caraïbe, où se trouve Capesterre-Belle-Eau, a rompu les équilibres, fin 2013. Il est survenu en parallèle au transfert de la compétence en eau des communes aux collectivités d’agglomération, en 2014.

La Générale des eaux a préféré partir. Présente depuis 1963 en contrats d’affermage renouvelés sans concurrence jusqu’en 2008, passée alors en prestations de service avec le Siaeag, la Générale des eaux a choisi d’en rester là. Avec un résultat net dégradé à partir de 2012, la Générale des eaux Guadeloupe affichait selon Veolia un déficit cumulé de 130 millions d’euros entre 2008 et 2017 (pour 513 millions d’euros de chiffre d’affaires). Elle avait été deux fois renflouée par l’actionnaire, via deux augmentations de capital de 15 millions d’euros en 2012 et de 69,2 millions d’euros en 2015, indique le rapport (note 637). Elle dément donc s’être enrichie : Sur 2005-2010, elle a distribué 3,9 millions d’euros de dividendes en cumul, à rapprocher des 98,2 millions d’euros apportés en augmentation de capital et abandon de créances entre 1998 et 2017.
Les élus auraient dû contester ce départ précipité. En signant des protocoles transactionnels libérant la Générale des eaux de toute obligation, les autorités organisatrices ont montré une légèreté coupable, écrit le rapporteur. Ils auraient dû exiger qu’un accord garantisse la pérennité du service à l’issue du départ du prestataire et un dédommagement financier. Cette transsition mal menée et peu réfléchie a fragilisé le service de l’eau et balkanisé sa distribution entre territoires, favorisant notamment les contentieux sur les ventes d’eau en gros. ” Ceux qui manquaient d’eau en achetaient à ceux qui la détenaient sans pour autant la payer “, a expliqué l’ancien préfet, Philippe Gustin. L’État a été déficient dans son rôle de garant de la santé et de la salubrité publiques. Face à la dégradation d’un service public essentiel, ses représentants n’ont pas pris des mesures pour garantir l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous. Il a aussi manqué à sa fonction de conseil des collectivités territoriales.
Le rapport dresse également la liste d’une série de dysfonctionnements.
• Des choix d’équipements et de matériaux peu judicieux. Plusieurs intervenants ont évoqué l’installation de canalisations de remplacement en PEHD (un plastique de haute densité), qui vieillissent prématurément au contact de l’eau très chaude des Antilles.
• Crise de gouvernance, plus que détournement massif. La crise de l’eau est une crise de gouvernance, prise dans une spirale délétère, et non la conséquence d’un détournement massif de fonds publics au profit d’acteurs privés, écrit le rapporteur Olivier Serva.
• Des déplacements, frais de réception et de communication du Siaeag disproportionnés. 6,9 millions d’euros ont été dépensés par le Siaeag entre 2005 et 2011, en missions, déplacements, réceptions et communications. Dont 4 éditions des Journées de l’Eau, organisées tous les deux ans et passées de 2 à 5 jours, ont coûté 3,5 millions d’euros.
• Des élus ont pris part à des votes sur des sujets auxquels ils étaient personnellement intéressés, susceptibles d’être qualifiés de prise illégale d’intérêts, pour lesquels ils auraient dû se déporter. Mais c’est un manquement à l’éthique, et rien ne permet d’affirmer qu’il y a eu contrepartie, ce qui caractériserait une corruption. Mis en cause par Victorin Lurel pour avoir quitté la Générale des eaux avec 250 000 €, Dominique Théophile a ainsi expliqué qu’il s’agissait là du produit de sa rupture conventionnelle, dans le cadre d’un accord d’entreprise, après 35 ans de salariat au sein de la Générale des eaux. En revanche, il a admis avoir voté en faveur d’un protocole d’accord entre Cap excellence et la Générale des eaux, alors qu’il aurait, compte tenu de sa carrière au sein du groupe, dû se déporter. Également mis en cause, Jacques Gillot a eu plus de difficultés à se défendre, sur l’embauche de son fils à la Nantaise des eaux, qui a pris en 2009 le marché de l’irrigation, attribué par le conseil général qu’il présidait. La commission a saisi le procureur de la République. Suite à des déclarations contradictoires de Amélius Hernandez, Germain Paran et Ferdy Louisy, auditionnés sous serment, la commission a transmis son rapport au procureur de la République ” pour l’ouverture d’une enquête plus large sur des éventuelles malversations dans l’attribution et la gestion des marchés d’eau et d’assainissement en Guadeloupe “. Amélius Hernandez avait notamment affirmé que la Générale des Eaux payait Germain Paran pour l’accuser et qu’il ” passait chercher des enveloppes dans le bureau de la Générale des eaux Guadeloupe “. Ferdy Louisy a évoqué une ” subvention de 6 000 € ” versée par le Siaeag au comité des usagers de l’eau. Germain Paran a démenti ces informations et affirmé qu’Amélius Hernandez avait fait embaucher sa fille à la Générale des eaux. La commission d’enquête affirme qu’elle ” n’a pas obtenu d’éléments substantiels permettant de confondre les bénéficiaires de détournement de fonds et regrette que les dénonciations prononcées par les personnes auditionnées ont été soit très vagues et sans auteur identifié, soit non étayées par des éléments précis “.
• L’état de l’assainissement est un scandale au moins aussi important. Selon l’Agence régionale de santé, si rien n’est fait, il n’y aura d’ici à 10 ans plus aucun point de baignade de qualité excellente ou très bonne dans l’archipel, écrit le rapporteur.
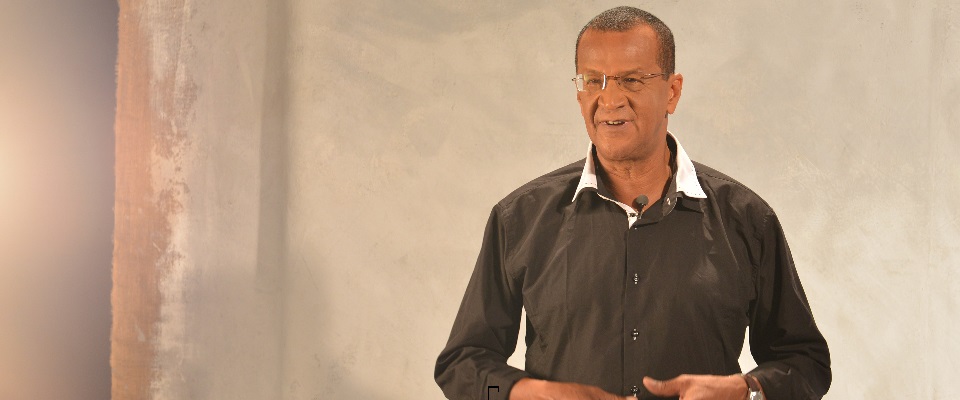
Le prix de l’eau en Guadeloupe reste parmi les plus élevés en France. Les prix moyens les plus élevés se situent en Guadeloupe (5,46 euros/m³), en Martinique (5,21 euros/m³), en Bretagne (4,87 euros/m³) et en Hauts de France (4,57 euros/m³). À l’opposé, en Provence-Alpes-Côte-D’azur (3,52 euros/m³), dans le Grand Est (3,77 euros/m³) et à la Réunion (2,61 euros/m³), les prix se situent en bas de l’échelle. Certaines collectivités facturent le mètre cube d’eau à plus de 5 euros, d’autres affichent des prix inférieurs à 2 euros, indiquait l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement en 2018. Certains élus ont mieux géré que d’autres. Gabrielle Louis Carabin a fixé un prix plus élevé d’un euro par mètre cube ce qui a permis de renouveler les investissements dans le réseau au sein du périmètre de l’agglomération du Nord Grande-Terre. Cap excellence a aussi veillé à percevoir les surtaxes destinées à financer le renouvellement des réseaux.
Au final, il ressort de ces travaux que deux personnes auraient pu être auditionnées. Geoffroy Mercier, ancien directeur de la Générale des eaux Guadeloupe (aujourd’hui en activité à la Réunion). Marcelle Pierrot, préfète de Guadeloupe de janvier 2013 au 21 décembre 2014. Et une piste à creuser. Celle des 3 millions de mètres cubes d’eau ” donnés ” à chacune des régies Nord Grande Terre et Pointe à Pitre Abymes, alors qu’ils ont été facturés aux usagers.
Dix propositions pour la Guadeloupe
Le rapport de la commission d’enquête contient dix propositions spécifiques à la Guadeloupe (propositions 67 à 76). Plus une proposition générale : élargir le déclenchement du plan Orsec à la réquisition des moyens nécessaires, quand l’urgence sanitaire, notamment la défaillance de la distribution de l’eau, l’exige.
– Maintenir, à titre transitoire, les équipes techniques de chaque régie existante au sein du syndicat mixte ouvert mis en place le 1er septembre 2021, en mutualisant les fonctions stratégiques et de support.
– Annuler les factures d’eau anciennes non réglées à la date de création du syndicat mixte unique de l’eau lorsqu’elles ne correspondent pas à une consommation normale ou à la capacité financière des usagers.
– Engager un plan de renouvellement général des compteurs d’eau.
– Faire apurer par l’État les comptes de liquidation des syndicats et régies afin que le nouveau syndicat mixte ouvert et les communautés d’agglomération n’aient pas à supporter les conséquences des gestions passées.
– Créer une filière de formation aux métiers de l’eau.
– Rendre systématique la recherche de la présence d’amibes thermophiles dans les eaux douces chaudes utilisées pour la baignade.
– Faire de l’assainissement un objectif prioritaire au même titre que le rétablissement de la distribution d’eau potable.
– Mettre en place un plan de protection de l’intégralité des aires d’alimentation des captages d’eau potable.
– Améliorer la sécurité des installations d’eau potable contre les intrusions et les potentiels actes de malveillance.
– Prendre en charge par l’État les frais de traitement de l’eau potable rendu nécessaire par la présence de chlordécone.
Les ajouts de Mathilde Panot
La présidente de la commission d’enquête Mathilde Panot a tenu à ajouter aux mesures durables recommandées par la commission sa propre liste de mesures d’urgence, destinées à ” améliorer les conditions de vie des Ultramarins dès maintenant “. Le plan Orsec eau potable doit être mis en œuvre en Guadeloupe au plus vite. Pour tous les territoires concernés, un bouclier sur le prix de vente des eaux en bouteille doit être appliqué, sachant que le prix de l’eau en bouteille est 2 à 5 fois plus élevé en Guadeloupe que dans l’Hexagone. L’état de crise sanitaire doit être reconnu aux Antilles, où la contamination des eaux, des milieux et des habitants au chlordécone est une catastrophe dont on ne mesure pas la pleine ampleur, au regard des effets cocktails insuffisamment étudiés avec d’autres substances. Pour la Guadeloupe, elle fait dix autres recommandations : supprimer les factures exorbitantes des citoyens en Guadeloupe ; garantir une participation décisionnelle des citoyens dans le nouveau syndicat mixte ouvert ; garantir que ni la dette existante, ni les investissements pour la remise à niveau immédiate des réseaux, ne soient répercutés sur la facture des usagers de l’eau ; garantir l’avenir professionnel des salariés du Siaeag ; mettre aux normes sécuritaires les captages et les équipements de gestion de l’eau et de l’assainissement ; mettre en place un plan de financement conséquent et financé par l’État pour le renouvellement des infrastructures pour l’eau potable et l’assainissement ; l’État doit financer le procédé de filtration au charbon actif contre le chlordécone ; favoriser le retraitement de la chaux et du charbon utilisés dans le processus de potabilisation sur place, plutôt que de l’envoyer dans l’Hexagone ; instaurer un bouclier des prix sur les packs d’eau en bouteille jusqu’à l’arrêt des tours d’eau et le rétablissement qualitatif de l’eau en Guadeloupe.




Poster un commentaire
Tu dois être connecté Poster un commentaire.