Les performances de l’Université des Antilles dans le classement de Shanghai en 2024 marquent un recul global par rapport à 2023 (année de son entrée dans le classement), malgré quelques progrès dans certains domaines spécifiques. Les progrès sont notables avec une percée en production académique de classe mondiale (passant de 0 à 24,1) et une légère amélioration de la recherche de haute qualité (de 20,3 à 21,2).
Mais ces avancées sont éclipsées par des reculs importants. L’impact de la recherche subit une chute spectaculaire (de 81,7 à 41,8), qui reflète une baisse de la reconnaissance des travaux scientifiques sur la scène internationale. Plus marquant encore, la collaboration internationale, point fort en 2023 avec un score de 88,4, s’effondre à 17,8, traduisant une perte significative de partenariats stratégiques.
Le 2 décembre, le président de la Région Guadeloupe a pourtant salué une « récompense » pour l’Université des Antilles (UA), évoquant son « ancrage international » et son rôle en tant qu’« acteur majeur du bassin caribéen dans le domaine de la recherche en écologie ». De son côté l’exécutif départemental Guy Losbar a déclaré que « l’Université des Antilles, en confirmant sa place dans ce classement exigeant, démontre à nouveau que notre région est un vivier de talents, capable d’apporter des contributions significatives aux grands enjeux environnementaux mondiaux. »
Derrière ces louanges dithyrambiques liées au fait que l’UA figure à nouveau parmi les 500 universités mondiales scorées en écologie, se cache une place qui demeure modeste, à la limite inférieure du classement.
Dans le domaine académique de l’écologie, l’UA est dans le dernier centile des 500 institutions répertoriées par le classement de Shanghai 2024. Parmi les 28 universités françaises présentes, l’UA est classée 27ᵉ. Selon un observateur de la vie universitaire, l’Université des Antilles doit sa présence dans ce classement à la contribution du Laboratoire de biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques (Boréa) dont la photo ci-dessous illustre les travaux.

Ce laboratoire, partagé avec l’Université de Caen Normandie et l’université de la Sorbonne, joue un rôle clé dans la production scientifique en écologie. Toutefois, chaque institution obtient ses propres scores, et l’écart entre l’UA et la Sorbonne, par exemple, est significatif. En 2024, la Sorbonne occupe la 20ᵉ place mondiale avec des scores élevés en recherche de haute qualité (77,6) ou en production académique de classe mondiale (71,9).
“En 2020 l’aide accordée aux étudiants représentait 98 % de l’enveloppe consacrées par les collectivités de Guadeloupe à l’enseignement supérieur et la vie étudiante”
Cour des comptes, novembre 2024
Des discours officiels dithyrambiques
Les réactions institutionnelles sont en décalage avec la réalité du classement. Dans son communiqué du 1er décembre, l’UA évoque une « distinction renouvelée » qui témoigne de « l’excellence » et de la « prolifique » recherche menée par l’institution. Michel Geoffroy, président de l’UA, a adressé ses « félicitations appuyées » à l’ensemble du personnel universitaire, soulignant une « réussite d’équipe ».
De son côté, le président de la Région Guadeloupe, dans un langage encore plus enthousiaste, a qualifié ce classement de « consécration » qui fait « rayonner la recherche caribéenne au niveau mondial » et traduit « la montée en puissance de la recherche à l’UA ».
Ces déclarations, bien que valorisantes, ne reflètent pas fidèlement la réalité. Qualifier ce classement de « consécration » pourrait donner une vision biaisée de la situation. Si la présence de l’UA dans le classement de Shanghai est en soi un accomplissement, il faut reconnaître que l’institution reste loin des standards des meilleures universités internationales.
Des éléments tels que l’absence totale d’enseignants-chercheurs de classe mondiale (score : 0) ou la faiblesse des collaborations internationales (17,8) montrent les limites structurelles auxquelles l’UA fait face. Par ailleurs, sa performance repose en grande partie sur un laboratoire partagé avec d’autres institutions plus performantes.
Figurer dans un classement mondial est certes un point positif pour une université de taille modeste, mais elle ne doit pas occulter les défis persistants. Il y a moins d’un mois, le 12 novembre, la Cour des comptes publiait un rapport dans lequel étaient pointés un déficit d’attractivité, une recherche peu visible, une gestion défaillante, « des politiques de formation, de recherche et de vie étudiante, dont les résultats souffrent d’un déficit de stratégie et de coordination ».
Se basant sur une enquête de 2021 qui avait porté sur « le financement de la recherche, du transfert de technologie, de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante par les collectivités territoriales », la Cour désigne des collectivités ultramarines « qui sont globalement moins investies en matière de recherche ». En 2020, « les collectivités de Guadeloupe ont consacré 4 millions aux politiques publiques d’enseignement supérieur et de vie étudiante » souligne le rapport. Non sans préciser des différences majeures dans les priorités. En 2020, l’aide accordée aux étudiants représentait 24,5 % de l’enveloppe consacrée à l’enseignement supérieur au niveau national, contre 98 % en Guadeloupe (83,7 % à La Réunion, 80,5 % en Guyane et 63,2 % en Martinique).
Les moyens consacrés à la recherche & développement des entreprises implantées en Guadeloupe étaient évalués à 2,1 millions en 2019, soit l’équivalent de 27 chercheurs à temps plein.
« Nous continuerons à accompagner l’Université des Antilles comme nous l’avons toujours fait, avec la mise en place de la formation d’ingénieurs, ou encore de la licence professionnelle aux métiers de la mer, dont la première promotion sera diplômée ce mardi [3 décembre]. Des formations permettant de faire briller la jeunesse guadeloupéenne », affirme l’exécutif régional.
« Mais au-delà des mots, la véritable ambition nécessite des moyens concrets et un regard honnête sur les défis à relever. Car, en fin de compte, la réelle qualité de travail des étudiants et des personnels universitaires, elle, ne trompe jamais personne » conclut l’observateur.


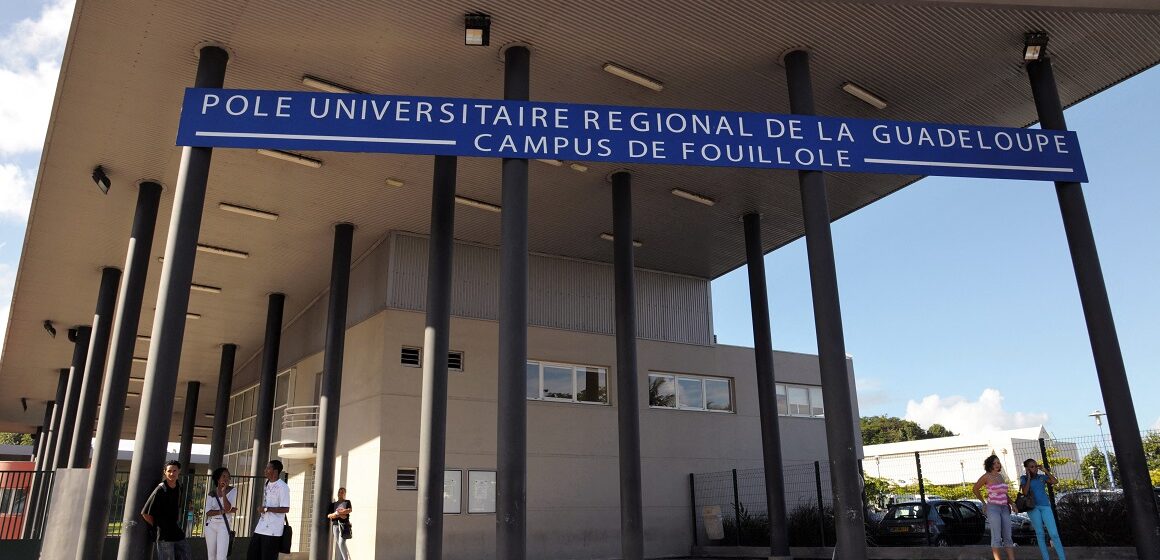

Poster un commentaire
Tu dois être connecté Poster un commentaire.