La jeunesse guadeloupéenne est une espèce en voie de disparition. À l’horizon de 2030, la Guadeloupe sera l’une des plus vieilles régions de France. Décryptage.st une espèce en voie de disparition. À l’horizon de 2030, la Guadeloupe sera l’une des plus vieilles régions de France. Décryptage.
Démographiquement, l’Outre-Mer a connu une période faste dans les années soixante avec une population dynamique faisant partie des plus jeunes de France. Aujourd’hui, la réalité est bien différente et la population ne vit que dans l’illusion d’une jeunesse désormais quasiment perdue. Les 35-65 ans représentent une très large part des habitants, face à des 20-35 ans de moins en moins nombreux. Selon une étude menée par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et l’Insee, en 2030 la Guadeloupe fera partie des régions les plus vieilles de France au même rang que l’Auvergne et le Limousin. Plusieurs facteurs expliquent l’origine de ce coup de vieux. Le premier est que la transition démographique c’est-à-dire le passage d’une natalité et une mortalité élevée à une mortalité et une natalité faible, et les comportements familiaux des Guadeloupéens ont évolué très rapidement. Ces changements ont pris cinquante ans, là où il a fallu parfois plus d’un siècle pour l’Europe. Il n’y a pas eu de palier de décompression entre l’époque où les femmes avaient plus de trois enfants et celles où elles n’en font qu’un ou deux. Le deuxième facteur réside dans les rapports migratoires entretenus avec l’Hexagone. On observe un flux pendulaire entre des Antillais de 50-60 ans de retour dans leur région pour prendre leur retraite, et les diplômés du secondaire ou de l’université qui partent achever leur formation dans les écoles françaises ou étrangères. Et enfin, à l’instar d’autres pays dans le monde, l’amélioration sensible des conditions sanitaires et des soins ont allongé l’espérance de vie des Guadeloupéens qui vivent plus longtemps.
ENJEUX
Fuite massive des cerveaux
En dehors de l’urgence démographique, c’est le profil des migrants qui est en question. L’étude démontre que les étudiants natifs de Guadeloupe partis à l’étranger ont tendance à s’y installer durablement : seuls 25 % des titulaires du Bac reviennent en Guadeloupe et 65,7 % des Guadeloupéens détenant un diplôme supérieur, deviennent des actifs et s’installent dans leur pays d’accueil. Au contraire, 40 % des migrants peu ou pas diplômés, reviennent dans leur pays d’origine. La Guadeloupe est donc victime d’une fuite systématique de ces jeunes qualifiés et formés vers la France hexagonale, le Canada ou les États-Unis et est condamnée à attendre leur retour à quelques années de la retraite. Qui reste-t-il sur place ? Des jeunes non-qualifiés, non formés aux buttes avec un chômage galopant et des retraités ayant déjà accompli leur vie ailleurs. C’est donc d’une véritable locomotive sociale et économique dont est privé le pays, condamné à terme à être tiraillé entre la construction de prisons ou de maisons de retraite. L’enjeu des prochaines années sera de déterminer quelles politiques d’intéressement mettre en place pour faire revenir les cerveaux dont la Guadeloupe a tant besoin.
LONGUE AGONIE
La démographie négative, véritable bombe à retardement
La dynamique de la démographie est un indicateur infaillible de la santé socio-économique d’un pays. Aussi une démographie stagnante voire négative est une bombe pour la cohésion sociale et cela à plusieurs titres. Dans un premier temps, le poids financier de l’accompagnement des séniors et de la rémunération des retraites est une véritable contrainte sur le budget des politiques publiques et sur l’économie. Ensuite, le marché de l’emploi, fonctionne – quand il fonctionne – sur la demande de jeunes candidatures formées et diplômées. Or, dans les perspectives futures, c’est exactement ces forces qui manqueront en Guadeloupe. Avec un marché de l’emploi en panne, les risques de délinquance augmentent sensiblement. Ce cas de figure, est d’ailleurs déjà flagrant dans l’observation de l’actuelle société guadeloupéenne. Ce sont donc des milliers d’euros qui devront être réservés et déboursés en programmes de réinsertion des délinquants et accompagnement des retraités. Enfin, un vrai danger pèse sur les plans de développement qui tablent encore sur la perspective d’une démographie vigoureuse. Au cœur d’une situation sociale de plus en plus étouffante, c’est chronique d’une mort annoncée qui se joue en Guadeloupe si le cap n’est pas rectifié.

TROP VIEUX, PAS DE JEUNES
Des perspectives peu réjouissantes
La Guadeloupe fait face à la même problématique que nombre de pays développés. Elle doit trouver un moyen de gérer – avec réalisme — le destin des deux extrêmes de la vie : sa jeunesse et ses retraités.
En 1954 Plus de la moitié de la population à moins de 20 ans Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 6 5,3 6 à 10 enfants par femme Effectif par tranche d’âge Une baisse du nombre d’enfant par femme 1,3 2005 Les migrations massives font chuter la natalité depuis 1950 n 2030, la part des plus de 60 ans représentera 40 % de la population guadeloupéenne contre 26 % pour les plus de 25 ans. Selon Claude-Valentin Marie, directeur scientifique de l’étude Migrations, familles et vieillissement ” la Guadeloupe et la Martinique connaissent un bouleversement démographique important. Dans dix ans la société n’aura pas du tout le même visage. ” Alors que faire pour gérer cette nouvelle donne ? S’engager sur la voie d’une politique nataliste aurait l’impact d’un coup d’épée dans l’eau, ” cette évolution d’ensemble repose sur des choix personnels. Désormais les Guadeloupéennes ne sont plus disposées à s’occuper de cinq ou six enfants comme leur grand-mère ” estime Claude-Valentin Marie. D’autant qu’à l’arrivée ils ne seraient que plus nombreux à s’envoler vers la France ou l’étranger pour parfaire leur formation. Il faut donc réussir à faire revenir la jeunesse guadeloupéenne partie ailleurs, en lui offrant des perspectives d’avenir. L’accomplissement de cet objectif passe par la redéfinition de la politique économique, par un projet de développement abouti, sur le plan régional et communal qui permettrait la création de postes qualifiés attractifs pour les diplômés et les jeunes hautement qualifiés. À terme, il pourrait entraîner le renforcement de la formation locale pour que certaines filières se développent en Guadeloupe même. L’autre enjeu réside dans la capacité à anticiper le problème de la dépendance des retraités. Cela demande aussi des structures innovantes qui prendraient le relais pour ceux qui ne disposent pas d’un tissu familial fort. Mais il ne faut plus se fendre en conjecture, il y a urgence à agir !
Richard Vercauteren analyse les conséquences du vieillissement
Richard Vercauteren, sociologue, explique que le principal problème du vieillissement de la population est essentiellement un problème économique – à la fois étatique et particulier — d’autant plus crucial dans la conjoncture actuelle.
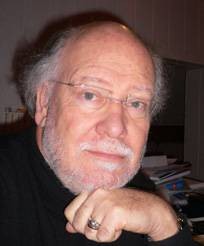
Le Courrier de Guadeloupe : Quelles sont les conséquences sociales d’un vieillissement de la population, pourquoi est-ce un phénomène qui peut devenir inquiétant ?
Richard Vercauteren : La personne âgée pose un problème majeur qui est celui de la prise en charge et de l’accompagnement. Il faut aussi évaluer jusqu’à quel point elle peut faire preuve d’autonomie. Une personne de quatre-vingts ans demande des infrastructures médicales importantes et sollicite un investissement financier et physique de la famille mais aussi du Conseil Général. Dans ces conditions, l’aspect quantitatif est un enjeu majeur pour les autorités publiques, mais aussi pour les structures familiales.
Une cohabitation saine entre les jeunes et les vieux peut-elle exister dans de telles sociétés ?
Il est clair qu’il peut y avoir quelques problèmes de gestion du fossé générationnel aggravés par la différence de rythme de ces deux âges. Mais en réalité ce n’est qu’un phénomène ponctuel. La vérité, c’est que les jeunes ont leurs propres activités et leur propre rythme qui sont souvent incompatibles avec la prise en charge de leurs aînés. Ce problème n’existe pas dans les sociétés où les femmes ne travaillent pas et sont alors responsables de la prise en charge des plus jeunes et des plus vieux. Mais dans les sociétés modernes, occidentales un tel schéma n’est pas possible.
En termes de politiques publiques, quelles solutions innovantes et efficaces peuvent être trouvées ? Comment les pays européens gèrent-ils ce problème ?
En termes de finances publiques moins l’État s’investit plus la charge est dévolue aux familles. Ce sont désormais les politiques familiales qui aident à gérer la prise en charge des personnes âgées. Finalement, c’est un transfert de compétences. Tous les pays européens font face à ce même problème et le gèrent plus ou moins bien avec des environnements de moins en moins médicalisés et axés sur l’accompagnement et la présence. En Italie, en France ou en Allemagne, des efforts sont faits pour que les retraités vivent dans des conditions décentes, mais on se demande toujours où les mettre pour qu’elles coûtent le moins cher. En Grande-Bretagne, en revanche, elles sont désavantagées car elles vivent dans une société où tout est très cher pour elles, sans avoir le soutien financier nécessaire pour vivre dans des conditions décentes.





Poster un commentaire
Tu dois être connecté Poster un commentaire.