VAN LÉVÉ
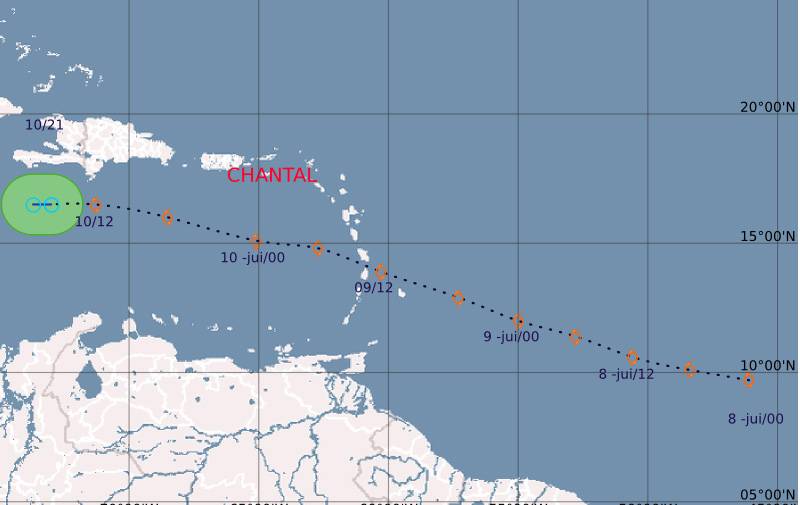
En termes de prévisions cycloniques, cette année présente à peu près le même visage que 2012 avec toutefois un léger regain d’activité. Selon les calculs et l’analyse des modèles, près de quinze phénomènes cycloniques susceptibles d’être nommés – c’est-à-dire des tempêtes dont les vents dépassent les 70 km/h – devraient traverser l’Atlantique et l’arc antillais. Les prévisionnistes du National Hurricane Center (NHC) de Miami, responsable de la surveillance de la zone Atlantique et Caraïbes, vont un peu plus loin et estiment que parmi cette moisson, devraient surgir six ouragans de forte intensité avec des vents dépassant les 170 km/h. Ces bilans confirment que l’influence de la Niña – phénomène climatique causé par une anomalie des températures de l’Océan Pacifique – sur la saison cyclonique tropicale reste très forte. La zone caraïbe reste dans un cycle qui a été entamé en 1995, caractérisé par des températures de l’Océan Atlantique et de la Mer des Caraïbes plus chaudes que la moyenne. Cette même anomalie climatique est aussi responsable de la virulence de la Mousson africaine. La vigueur de la Niña s’est clairement révélée en 2005, l’année la plus active de la dernière décennie, qui a vu la formation de 27 phénomènes nommés dont la tristement connue Katrina qui a ravagé la Nouvelle Orléans. La petite n’étant toujours pas calmée, et sans aucun signe de formation d’El Niño, le phénomène inverse – températures anormalement élevées des eaux au large du Pérou, provoquant des conditions atmosphériques qui rejettent les précipitations vers l’Est et provoquent une chute des températures des eaux aux large de l’Amérique du Sud, coupant ainsi la trajectoire et réduisant considérablement les conditions de formation des cyclones – le théâtre de la saison cyclonique est dressé, il est prêt et attend ses acteurs.
Plus les prévisions sont éloignées moins elles sont fiables
L’exactitude des prévisions, voilà encore une question récurrente. Principe de base à admettre ” Plus les prévisions sont éloignées dans le temps et plus la fiabilité chute “, explique Alain Muzellec. La fiabilité de la prévision dépend d’un système à l’autre. Une extrême variabilité qui s’explique par l’état des recherches et des technologies d’observation. L’amélioration des connaissances montre que tout système dépressionnaire est extrêmement sensible à son environnement. Toutefois un facteur est à mettre en évidence : la rapidité du phénomène. Une progression rapide du phénomène n’amène pas de surprise quand à sa trajectoire et même pour son intensité dans une moindre mesure. À l’inverse, un phénomène qui progresse lentement aura plus de chance de changer de trajectoire, et gagner ou perdre en intensité. Un impact direct donc sur la fiabilité des prévisions qui malgré tout restent pour des délais courts extrêmement importantes.
Modèle américain ou modèle français, peu de différence
Base de la prévision météorologique, les deux modèles français et américain diffèrent par leur calculateur. Le modèle français a la particularité de for cer les valeurs relevées par les collecteurs de données si celle-ci est en cohérence avec une perturbation des valeurs moyennes observées. Toutefois, modèle américain et français prennent en compte les mêmes facteurs de développement et ne sont donc pas fondamentalement différents. Le modèle américain ou Global Forecast System met à disposition du monde entier ses données. Il est actualisé quatre fois par jour à 5 h 40, 11 h 40, 17 h 40 et 23 h 40. Il calcule pour une météo complète, jusqu’à seize jours contrairement au modèle français qui ne va que jusqu’à 10 jours. Même s’il ne faut pas présumer de la fiabilité de ces calculs qui eux aussi doivent être considérés plus comme des tendances à partir du septième jour. Autre différence, un calcul de prévision dure six heures pour le modèle français tandis que le GFS prend 1 h 30. Une rapidité qui n’enlève rien à la fiabilité de la prévision au contraire. Quoi qu’il en soit, que ce soit l’un ou l’autre les deux modèles permettent d’avoir une vision à l’avance du temps et contribuent à leur façon à la protection civile.
On n’arrête pas le progrès
Depuis une vingtaine d’années, la prévision cyclonique a fait un bond considérable. Les prévisions sont en perpétuels progrès. Elles sont également très étroitement dépendantes des calculateurs. ” Ils relèvent l’ensemble des facteurs de la formation d’un cyclone “, explique Alain Muzellec, du centre de météorologie de Guadeloupe. Amas nuageux, température des eaux de surface (50 m d’épaisseur pour la bande d’eau), les vents, la pression au cœur du phénomène et la proximité de l’équateur sont les principaux facteurs ainsi pris en compte. Une fois les mesures de tous ces éléments rentrées dans le calculateur celui-ci émet des modèles de développement possibles pour le phénomène observé. Plus ces calculateurs sont puissants et plus les prévisions vont être précises. ” L’état des recherches en matière de prévisions est intrinsèque à l’évolution de ces calculateurs “, reprend le scientifique. L’aspect le plus défaillant de la prévision concerne l’intensité des cyclones. Cela est dû à la complexité des processus physiques engagés dans les changements d’intensité mais aussi aux limites de la technologie. C’est pour cela que les efforts sont concentrés sur cet aspect de la prévision. Aujourd’hui, il y a une systématisation de la récolte de données dans le noyau interne des cyclones, grâce à des avions ou des drones. Plus la technologie évoluera plus les prévisions s’amélioreront.
Priorité au délai de prévision
Véritable obsession en matière de prévision, le délai est primordial. Toute la recherche est organisée afin qu’il soit constamment amélioré. Il faut savoir que la prévision météorologique est une prévision et non une prédiction. Cela implique qu’elle soit en permanence remise à jour. Les calculateurs doivent rentrer de nouvelles données et produire d’autres modèles de développement envisagé pour un phénomène constamment. ” On peut prévoir la trajectoire et la position d’un cyclone avec un délai de 24 heures avec une précision de 100 km et dans un délai de 48 heures avec une précision de 200 km “, explique Alain Muzellec, scientifique du centre de météorologie de Guadeloupe. Car malheureusement plus le délai est court moins la précision est grande. Cela s’explique par l’inconnu de l’état de l’environnement et donc des facteurs qui influent sur le phénomène. Concernant les prévisions normales, ” Aujourd’hui nos technologies permettent de prévoir le temps et donc un phénomène météorologique sur 10 jours dans l’hexagone et 5 en Guadeloupe car les conditions climatiques sont beaucoup plus changeantes “, détaille le scientifique. Encore une fois, ce sont les avancées technologiques et l’observation des phénomènes qui permettent d’améliorer ce délai et de le raccourcir, afin que prévision et prévention s’allient pour une sécurité renforcée de la population.
THERMOMÈTRE ET TUBE DE TORRICELLI
Et le satellite leur rendit la vue !
Pendant longtemps, les populations ne faisaient connaissance avec les cyclones que lors de leur arrivée à terre… trop tard ! Ce n’est qu’en 1960 que les choses ont évolué dans le sens de prévisions précises.
D’une manière générale, l’Histoire de la météo s’est faite à tâtons, entre de longues périodes d’abandon et de brutales avancées. La prévision cyclonique ne déroge pas à la règle. Des archives retraçant le passage de cyclones sur la Guadeloupe et la Martinique remontent au dix-sept siècles. En prenant ce point de départ, et jusqu’aux années 60, les populations n’avaient aucun moyen de savoir avec certitude si elles étaient concernées par un cyclone et étaient régulièrement prises de court. D’où les pertes humaines après le passage du phénomène. Pas d’alertes, pas de confinement. L’exemple de plus frappant a été le cyclone de 1928. D’une violence rare, le phénomène, on le sait maintenant de classe 4, a emporté 1200 personnes dans sa rage. Mais les leçons ont été tirées. Tout au long du 20 ème siècle, les Britanniques et les Américains ont tenté quelques prévisions notamment grâce au baromètre. Mais ce sont les américains qui, les premiers, se sont frottés aux ouragans. Dans le but de rassembler des données océanographiques, les militaires américains ont affrété des avions de l’US Air Force chargés de voler au cœur de ces systèmes. En 1943, a lieu le premier vol dans un ouragan. Il est quasi meurtrier pour les pilotes surpris par l’étendue du phénomène, mais qui en reviennent et transmettent les données aux services météorologiques. Leur accumulation donne naissance au National Hurricane Center. Mais ce sont les satellites, en 1960 qui changent définitivement la donne. Ils deviennent les yeux des scientifiques sur la planète et leurs données, permettent par la suite la mise en service de calculateurs, de bouées océanographiques, et de logiciels qui émettent des modèles de prévisions. L’ère de la prévision cyclonique avait démarré.
Les six piliers du géant
Pour qu’un ouragan voie le jour un certain nombre de conditions doivent être réunies. L’embryon provient d’un amas de cumulonimbus (nuage d’orage) ou d’une ligne de grains associé à un axe dépressionnaire des couches basses et moyennes de la Troposphère circulant d’est en ouest. Cet embryon est nourri par l’évaporation d’une eau de mer dont la température est égale ou supérieure à 26.5 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur. À ce stade, la machine thermodynamique est en place. Viennent ensuite des conditions de vent en altitude optimales plus précisément des vents réguliers sur 12 à 15 kilomètres d’altitude. Même sens, même force. Cette condition permet de souder et d’organiser la partie active de la dépression. Elle entraîne un courant ascendant qui fait baisser la pression en basse altitude et la fait remonter en haute. Les particules d’air sortent du bas, remontent et s’échappent. Le système devient autonome et s’auto-alimente. Tout cela pas trop près de l’équateur, et le monstre est né.
JOUER A DIEU
Les destructeurs de cyclones se creusent les méninges…vainement
La recherche avançant, des idées parallèles ont commencé à germer… non pas dans le sens de la compréhension du phénomène, mais dans celui de sa destruction pure et simple.

Savants fous ou brillants visionnaires. La limite est toujours floue. Quoi qu’il en soit, les projets à l’étude pour détruire les cyclones émanent de scientifiques reconnus et ont la confiance de célèbres investisseurs. En 2009, Bill Gates aurait acheté cinq brevets scientifiques qui proposaient des solutions pour la destruction des cyclones. Parmi eux, celui d’un scientifique de haut vol, mais particulièrement excentrique Nathan Myhrvold. Ce surdoué, responsable de recherches de développement de Microsoft pendant 13 ans et détenteur d’un doctorat en physique théorique et mathématique depuis l’âge de 23 ans, entendait désamorcer les ouragans en les privant de leur carburant, c’est-à-dire la vapeur d’eau qui s’échappe des mers quand leur température augmente. Ça, c’est la théorie. La pratique ne manque pas de sel. “ Depuis plusieurs années de nombreux projets et travaux proposant des techniques de désamorçage des cyclones nous ont été proposés. Cela va de créer des nuages de glace ou laisser tomber des particules d’iodures d’argent dans la zone de formation d’un cyclone, refroidir l’océan avec du matériel cryogénique, modifier l’équilibre radiatif des zones de naissance des cyclones à, plus radicalement, exploser la tempête en y lançant une bombe à hydrogène. Mais tous ces plans oublient de tenir compte de la taille et de la puissance des cyclones tropicaux. ” explique Érica Rule météorologiste au National Hurricane Center de Miami. Certains projets ont été expérimentés et ont tous glorieusement échoué. La cause est toute simple. Un ouragan en pleine maturité dispose et déploie l’énergie de cinq bombes atomiques par seconde. La condensation de l’eau de mer dont il tire son énergie libère 400 milliards de watt soit la production de 400 centrales nucléaires à pleine puissance. La force contenue en son cœur, pulvérise les instruments de recherche. Alors qui s’y frotte ?
Processus du déclenchement de l’indemnisation
La prime d’assurance anticyclonique est calculée en fonction de la construction de la maison. Ainsi, les maisons en dur, bénéficiant d’équipements certifiés comme résistant aux cyclones auront une indemnisation plus basse que les maisons en bois. Si la demeure d’un assuré est frappée par un cyclone, alors il déclare le sinistre à son assurance qui diligente un expert. Après rapport, il détermine l’ampleur des dégâts et l’indemnisation sera calculée en fonction de ses conclusions. Quant à ceux qui ne sont pas couverts, ils peuvent bénéficier du déclenchement de l’état de catastrophe naturelle par les autorités. Mais, ils n’auront aucune certitude que le montant versé suffira à réparer tous les dégâts.
Pourquoi les tentatives de destructions sont-elles dangereuses?
L’homme domine la terre à un tel point qu’il en oublie parfois les conditions qui ont mené à sa création. Tout comme l’Univers, c’est un colossal déploiement d’énergie qui est à son origine. En baisse lente mais régulière depuis, cette énergie contenue dans les différentes couches terrestres, est le moteur de la vie sur Terre : les courants marins, les changements atmosphériques, la mécanique des plaques tectoniques. Tout comme les tremblements de terre, les cyclones interviennent comme des soupapes de décompression. Ils sont le transfert de l’énergie et de la chaleur accumulées par les océans à l’atmosphère et aident à la régulation de la température des eaux, ils sont même cruciaux à la vie de la faune marine. Les détruire c’est provoquer un autre dérèglement climatique. La survie de l’homme reste dans la précision de ses prévisions. Les météorologues l’ont bien compris.
Encore un peu d’Histoire…
Les chinois, puis les Grecs et enfin les autres… cet ordre de découvertes scientifiques semble immuable et la météorologie y obéit. Le premier livre concernant la météo a été écrit par un chinois, Nei Jing Su Wen au premier millénaire avant J.-C. Peu après Aristote rassemble sous le terme météorologie, les Sciences et Vie de la Terre. Pour ce qui est des ouragans, c’est le Lieutenant-Colonel William Reed, membre du Corps des ingénieurs Royaux qui effectue la première prévision en 1847 grâce à des données barométriques, et cerne le passage d’un cyclone sur la Barbade.
ASIRÉ PAS PÉTET’
Assurance anticyclonique : pas encore un réflexe
Même si les dernières années ont été clémentes, la Guadeloupe n’est pas à l’abri d’être un jour balayée par un cyclone. Un événement qui -s’il arrive — révélera de nombreuses carences au niveau des assurances.
Seule une minorité des Guadeloupéens sont assurés contre le risque cyclonique. Le constat est surprenant pour une île qui est autant soumise aux caprices de la nature. ” Les clients souscrivent rarement plus qu’une simple assurance habitation contre le vol et l’incendie. Ils ne pensent pas spontanément à se protéger contre les catastrophes naturelles. Cela s’explique essentiellement par leurs contraintes budgétaires. En clair, les clients souscrivent ce qu’ils peuvent payer. ” analyse Alain Buffon directeur de Via Assurances. Il est clair que l’assurance d’une manière générale représente un poste du budget des ménages d’autant plus que les clients qui viennent s’assurer le font à la fin de la construction d’une maison, ou lors de la conclusion d’un bail de location. Deux étapes qui impliquent de fortes dépenses. Au-delà de cela, c’est le réflexe même de s’assurer – en dehors de l’assurance auto qui est obligatoire – qui semble faire défaut en Guadeloupe. ” Dans les grandes lignes, les clients ne s’assurent que si un organisme de crédit l’exige, quand cela fait partie, par exemple, des formalités pour contracter un prêt. ” D’un autre côté, les compagnies d’assurances n’encouragent pas vraiment un comportement préventif. Les dégâts causés par ce type de phénomènes sont tels que répondre aux demandes de ces clients sinistrés creuserait un gouffre dans leur trésorerie. C’est ce même raisonnement qui a mené au refus d’assurer des bâtiments situés en bord de mer. Si elles n’encouragent pas les clients à s’assurer, les compagnies n’aiment pas non plus les prises de conscience tardives. ” Elles voient d’un mauvais œil qu’un client souscrive une assurance anticyclonique en septembre par exemple, alors même que le risque est très élevé. D’autant plus que certaines maisons ont besoin d’un rapport d’expert précis pour calculer l’indemnisation. ” D’ailleurs, pour décourager toutes les tentatives, cette police d’assurance est fermée avant le début de la période cyclonique.




Poster un commentaire
Tu dois être connecté Poster un commentaire.